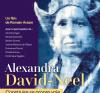Parle-t-on d’exaltation ou d’élévation pour la cérémonie du 3e grade ? Vous avez sans doute déjà lu sur des convocations le mot « exaltation » ; bien sûr, il y aura toujours des frères et des sœurs pour affirmer doctement que c’est tout à fait légitime d’employer ce terme et que puisque leur obédience les y autorise, c’est qu’ils ont raison.
Certes, l’exaltation évoque l’idée de magnifier, d’élever vers un état supérieur, ou encore de glorifier. On parle ainsi d’exaltation pour l’élévation au trône pontifical. Le Littré précise d’ailleurs : « Action d’inspirer à quelqu’un des sentiments élevés, nobles, de le porter à un très haut degré d’émotion spirituelle ». Ce qui n’est pas sans lien avec l’élévation spirituelle, morale et intellectuelle que le candidat est censé avoir au cours de la cérémonie de passage de grade.
Sauf que c’est une erreur. Comme le signale Mackey dans son Encyclopédie de la franc-maçonnerie de 1916 : « On dit d’un candidat qu’il est exalté lorsqu’il reçoit le grade de l’Arc Royal. » Et avant d’être exalté, le candidat devait avoir assumé la charge de Vénérable Maître.
Mais alors, d’où provient cette confusion ? Un faisceau d’indices nous mène vers le Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm. En cherchant, on découvre que c’est au sein du Grand Orient de France que l’expression s’est retrouvée consignée dans des rituels sans que cela soit contesté. Un plus grand examen serait d’ailleurs nécessaire pour savoir si cet hapax est antérieur à l’intégration de six loges et quatre triangles en 1999 qui ont permis de réveiller la patente du rite égyptien que le GODF détenait depuis 1862. Le « mauvais » usage s’est alors répandu dans d’autres rites et obédiences et depuis continue d’induire en erreur de jeunes frères et sœurs.
Reste la question de savoir qui de Robert Ambelain dans les années 1960 ou de Gérard Kloppel dans les années 1990, ou autre a introduit le terme dans la tradition maçonnique. Le débat reste ouvert et je serais ravi d’en discuter avec vous.