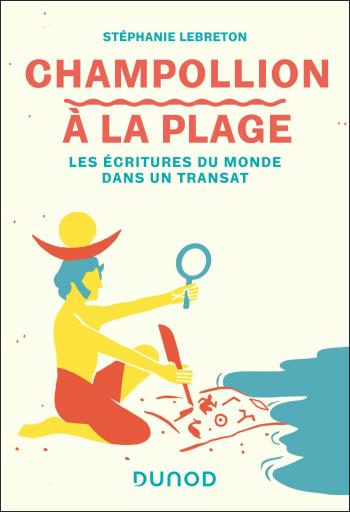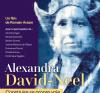Essai
Léo Taxil. Le prince des fumistes
De Robert Rossi
Les Éditions de la Tarente
430 pages — 27 euros
Taxil, inventeur des fake news ? Certes pas. Il y en a eu bien d’autres avant lui, mais ce mystificateur hors pair a ajouté à ses prédécesseurs une dimension qu’il maîtrisait à la perfection : la communication. Il a été un maître en la matière, qui a tenu en haleine le public pendant une dizaine d’années et cette biographie, tirée d’une thèse de doctorat d’histoire contemporaine nous le fait vivre dans ses moindres facettes, multipliant aussi les anecdotes sur ses contemporains, politiques ou religieux, n’oubliant pas le contexte général de l’époque et mettant en lumière bien des aspects culturels, politiques, sociaux d’une période qui constitue un creuset idéologique.
On voit un Taxil vivre très tôt pour l’écriture, mais toujours dans le registre du pamphlet, de la provocation. Avant de sombrer dans la dénonciation de la franc-maçonnerie, il a fait une belle carrière dans la production anticléricale, comme le montrent quelques titres de ses écrits : Les Bêtises sacrées, revue critique de la superstition (1880), Les Amours secrètes de Pie IX (1881), etc. Il est initié au Grand Orient en février 1881… mais est radié dès octobre de la même année ! Les frères n’apprécient pas ses outrances. Sa haine contre l’ordre maçonnique s’installe peu à peu. Puis il découvre la foi, rencontre le pape Léon XIII, abjure ses erreurs et se lance dans un antimaçonnisme forcené, sans limites : publication d’ouvrages, création de revues, fondation d’une ligue, ouverture d’une librairie, création d’une maison d’édition, etc. Il s’appuie dans ses écrits sur des sources authentiques, mais les remanie, les détourne, puis noie l’ensemble dans ses délires les plus fous et les plus insensés pour fustiger une maçonnerie qui inviterait Satan à ses tenues, organiserait des orgies, assassinerait des enfants. Il avance même que le prétendu Souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle, Albert Pike, rencontre Lucifer chaque vendredi à 15 heures ! Ses livres rencontrent un succès considérable, et il est soutenu par l’Église catholique, acceptant et diffusant sans barguigner ses calembredaines, certes convaincue (au moins depuis l’encyclique de 1884) que la maçonnerie était « la synagogue de Satan ». Sentant peut-être que le filon s’épuisait, et que ses mystifications allaient sombrer dans le ridicule, Taxil confesse en 1897 un gigantesque canular puis se retire et consacre les dernières années de sa vie à la publication de divers ouvrages. Ce génie de la fumisterie décède en 1907, oublié du public, et redevenu… libre-penseur ! On se pince parfois pour y croire, mais tout est établi avec précision par l’auteur, qui a su avec maestria et précision faire vivre cet homme prêt à tout pour arriver à ses fins et son époque. Noëlle Delomel
Essai
Champollion à la plage. Les écritures du monde dans un transat
De Stéphanie Lebreton
Éditions Dunod
199 pages — 15,90 euros
Volume après volume, la collection « À la plage » constitue une encyclopédie vivante sur des questions fondamentales, liées à la philosophie, la science, la culture… Avec une volonté et une méthode affirmées : apprendre, mais sans jargonner, dans un mélange d’analyses, de portraits et d’anecdotes. Contrat rempli avec les précédents titres, consacrés à Galilée, Darwin, Colette, Épicure ou Magellan…
Le nouveau volume s’intéresse à l’histoire de l’écriture, comment elle est née, son évolution. L’autrice part du connu, Champollion bien sûr, qui a résolu une énigme et révélé une civilisation, et nous offre une aventure de près de 5000 ans, de la Mésopotamie (où nait l’écriture, vers 3300 avant notre ère sur des tablettes d’argile) au Mexique, sans oublier la Chine, dont les premiers signes apparaissent sur des omoplates de bovidés ou des écailles de tortue. Les signes phonétiques d’origine nous deviennent compréhensibles, nous vivons presque dans l’intimité des scribes, nous comprenons que l’alphabet a entrainé une démocratisation du savoir. Cette plongée dans l’histoire du monde n’oublie pas les écritures indéchiffrées, celle des Mayas par exemple, et s’interroge en conclusion sur l’avenir de l’écriture, ou plutôt des écritures, confrontées aux nouvelles technologies qui paraissent tout emporter sur leur passage. Mais l’autrice est convaincue que « l’histoire est loin d’être terminée ». Acceptons-en l’augure. Noëlle Delomel
Bande dessinée
L’incroyable histoire de la médecine
De Jean-Noël Fabiani-Salmon et Philippe Bercovici
Éditions Les Arènes
325 pages — 26 euros
Chaque volume de cette collection « L’incroyable histoire » remplit haut la main son contrat : rendre compréhensible et accessible au plus grand nombre une question a priori ardue par l’humour notamment, tout en ne négligeant aucune approche scientifique ou technique. La forme utilisée, celle d’une bande dessinée, captive le lecteur dès les premières pages et ne le lâche plus ensuite.
Après la géographie, le sexe, les sciences, le vin… nous plongeons cette fois dans l’histoire de la médecine, de la Préhistoire à nos jours. Ce livre est le fruit de la collaboration d’un dessinateur, Philippe Bercovici et du professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, ancien chef du département de chirurgie cardio-vasculaire à l’hôpital Georges-Pompidou.
Une trentaine de chapitres composent cet ouvrage, les uns historiques, les autres thématiques. La médecine… une science ? Oui, une science pragmatique et rationaliste, longtemps confrontée aux mythes, aux dogmes religieux. Sans doute l’est-elle parfois encore un peu aujourd’hui…
Nous suivons les tâtonnements, les grandes avancées : la découverte de l’anesthésie, qui a permis de soulager les souffrances, ou celle des microbes puis celle de l’asepsie et des vaccins. Nous comprenons comment la dissection de cadavres a permis de comprendre le rôle du cœur et d’intégrer la notion de circulation sanguine. Nous vivons au plus près les grandes épidémies, variole, peste, choléra, avant d’être confrontés aux pandémies virales du XXIe siècle. S’enchainent des chapitres sur les avancées de la recherche qui confrontent l’humanité à des questions fondamentales, que les auteurs nous exposent clairement : les nanotechnologies, la robotique ou les manipulations génétiques. Du sérieux, bien sûr, mais les anecdotes et les portraits abondent, ceux des charlatans aussi et ils n’ont pas manqué au fil des siècles. Le passé est bien éclairé, les questions que nous nous posons tous sur l’avenir sont bien exprimées, le lecteur apprend beaucoup, avec le sourire aux lèvres : que demander de plus ! Noëlle Delomel
Bande dessinée
La Longue route
De Stéphane Melchior, Younn Locard et Joal Grange
Éditions Gallimard
344 pages — 29 euros
Une phrase de Bernard Moitessier s’impose pour ouvrir cette chronique du somptueux roman graphique consacré à son voyage mythique de 1968-1969 à travers les océans : « Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l’ont construit avec leurs rêves. » Tout est dit avec ces quelques mots ! Le navigateur a vécu ses rêves, et il est entré dans la légende le 18 mars 1969 quand il décide, après 7 mois de course autour du monde, alors qu’il est en tête et promis à la victoire, de faire demi-tour. Il envoie ce message à ses proches et aux organisateurs de la première course autour du monde en solitaire : « Je continue sans escale vers les iles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Il refuse la gloire, choisit sa propre vision du bonheur et de l’accomplissement, et continue sa route en solitaire. Solitaire ? Pas tout à fait, bien sûr, il le fait avec le Joshua, un ketch en acier de 12 mètres : son prolongement. Ils vivent ensemble, l’un pour l’autre, et le marin note dans son journal de bord, alors qu’il renonce à la course : « Ce n’est pas un abandon. Je suis toujours la longue route, j’ai juste changé de quête. C’est une quête spirituelle. Une histoire entre Joshua et moi. Une grande histoire d’amour qui ne regarde plus les autres. » La paix s’installe, l’état de grâce est total.
Quelques mois plus tard, après 300 jours en mer, il jette l’ancre à Tahiti, et publie en 1971 un livre, La Longue route, récit de son voyage, dont les auteurs de ce roman graphique se sont inspirés pour mettre en scène ce huis clos, magnifié par un dessin et des couleurs superbes, changeantes comme la mer et le ciel. Moitessier n’était pas pressé de retrouver la civilisation, le lecteur n’est pas pressé d’arriver à la fin de cette odyssée nautique, lui aussi en état de grâce.
Depuis 1993 le Joshua est classé monument historique. Moitessier est décédé en 1994. Pour ses obsèques, dans le cimetière de la commune bretonne de Bono, « son » Joshua est convoyé depuis La Rochelle pour saluer le navigateur. Tout est symbole. Noëlle Delomel
Bande dessinée
Moi, Jules César
De Montesquiou et Névil
Allary Éditions
256 pages — 28 euros
Jules César a marqué l’histoire de l’humanité, c’est une évidence. Depuis 2000 ans, les études n’ont pas manqué sur lui, les rayonnages bien remplis des bibliothèques en attestent ! Une de plus ? Certes, mais elle se situe à un autre niveau.
Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une bande dessinée, et le dessin de Névil est à la hauteur de César et de son épopée : ses cases éclatent parfois, pour donner plus de relief à tel événement, tel personnage, homme ou femme, tel monument, telle bataille sanglante. Il sait aussi jouer avec les couleurs. Un régal.
Ensuite par le scénario, dû à Alfred de Montesquiou, grand reporter, essayiste et réalisateur. Pendant trois ans, il a mené une enquête historique impressionnante, en rencontrant les plus éminents spécialistes de César, une trentaine au total. Son récit est nourri de leur savoir. Tout est établi avec précision. Bien sûr, là où les sources antiques se contredisent parfois, l’auteur s’y engouffre et nous livre ses choix narratifs, ses interprétations qui mettent en avant l’homme de chair et de sang derrière le mythe, sa cohérence interne, sa fragilité compensée par une détermination absolue, sa soif de revanche sociale, son art de la manipulation, son rapport aux femmes, son populisme, son orgueil démesuré à la fin de sa vie.
Enfin, par la forme retenue, celle de l’autobiographie de César. Tout commence ici par un dîner le 14 mars 44 avant notre ère, qui réunit à Rome 13 fidèles du « divin » César. Cet homme qui dressait un pont entre les hommes et les dieux revient sur sa vie, ses échecs, ses réussites, ses amours. Le lendemain, il avait rendez-vous avec la mort. Il avait souhaité une mort rapide et inattendue… souhait exaucé ! Le lecteur est happé dès les premières pages par cette épopée hors norme. Noëlle Delomel
Et aussi…
L’Évangile de Septimanie
De Jean-Luc Aubarbier
Éditions City
Face à la guillotine
Les nouvelles aventures de Guilhem Malbay
De Jean-Michel Roche
Éditions DETRAD aVs
Les ressuscités
De Jacques Ravenne
Éditions JC Lattès