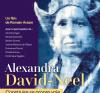Secret ! Le mot fascine depuis des siècles et bien davantage encore. Au mieux il intrigue, au pire il dérange, fait peur même, voire suscite la haine. Il regroupe tant de choses : secrets de famille, d’État, et bien d’autres non avouables quand il s’applique à des sociétés criminelles comme la mafia ou les triades chinoises. Et que dire de certaines sociétés religieuses, les Cathares, voire l’Opus Dei, ou d’autres à dimension politique, les Illuminaten, le Ku Klux Klan ou la Cagoule dans les années Trente ? Au-delà de ses buts, de sa finalité, une société secrète est une communauté humaine dotée d’une organisation dont les membres ont l’obligation de ne rien dévoiler, un mot clé s’impose alors, celui de silence. Ses membres y consentent.
Et la franc-maçonnerie ? Ses adversaires l’imaginent comme une société secrète, mais ses adeptes la voient discrète, même si ce mot « secret » apparait dans nombre de leurs travaux et publications. Il y aurait un « secret maçonnique » ? Ouvrons le dossier, sans prétendre à l’exhaustivité, occasion de revenir sur l’antimaçonnisme, aussi vieux que la franc-maçonnerie.
Dès l’apparition de la franc-maçonnerie ou presque, on a assisté à un déballage sur la place publique de documents, rituels, comptes-rendus de travaux divers, et le secret maçonnique a été l’objet de nombreuses attaques. Les textes abondent au fil des décennies, la condamnation est totale, par de nombreuses encycliques. Clément XII frappe dur dès 1738, avec In Eminenti Apostoleus Specula, excommuniant les francs-maçons et dénonçant « le secret dont ils s’entourent et entourent leurs travaux », eux qui cachant « par un silence inviolable tout ce qu’i