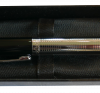Dans l’antiquité grecque, l’éthique concernait l’art de vivre en s’accomplissant, et elle couronnait l’édifice philosophique. Avec le christianisme, la morale s’en distingue très nettement. Le péché originel est passé par là et avant de s’épanouir l’être humain doit d’abord songer à se racheter en prenant ses distances avec les plaisirs de ce monde, la morale se fait abstinence. L’humanisme de la Renaissance renoue avec l’éthique du bonheur et intègre la morale au souci de l’accomplissement de soi. Descartes et Spinoza, entre autres, approfondiront cette synthèse et la philosophie des Lumières consacrera l’émancipation de la morale par rapport à la religion. Kant se distinguera tout particulièrement en formulant la morale du devoir qui voit dans l’action désintéressée le ressort du respect de l’humanité. Que va faire la philosophie moderne de tout cet héritage ? La question du rapport entre morale et religion va s’inscrire d’une nouvelle manière dans la pensée philosophique. Suivons ce renouveau avec Nietzsche, Freud, Dostoïevsky et Sartre, entre autres.
Avec Emmanuel Kant la morale reçoit une formulation qui semble indépassable. Énoncée indépendamment de la religion, elle permet au rationalisme de prendre un sens pratique exemplaire. Peut-on aller au-delà d’une conception qui fait du désintéressement la source intérieure de la loi morale et de l’humanité respectée comme fin en soi le ressort d’une façon d’agir universalisable ? Conférant au devoir le sens d’une liberté majeure qui dépasse le déterminisme naturel, Kant transfigure la morale en même temps qu’il exalte l’être humain en sa dignité ultime.
Mais deux présupposés sous-tendent sa problématique morale. D’une part la question du rapport entre morale et bonheur reste liée chez lui à une vision pessimiste de la nature humaine héritée du christianisme. Ce n’est pas par un élan spontané qu’un être capable de pécher agit moralement. Et comme le bonheur dépend du fait que tous agissent moralement et me traitent comme fin comme je le fais moi même, la liberté humaine le rend hypothétique. Pour qu’advienne le « règne des fins », Kant met alors en jeu le postulat théologique d’un Dieu bon et tout puissant qui veille à ce que le bonheur advienne à ceux qui s’en sont rendus dignes par leur conduite morale. Ce lien entre morale et bonheur n’a donc rien de certain. Il advient de surcroît, l’essentiel étant l’action morale désintéressée. La vertu morale ne consiste pas à viser le bonheur, mais à se plier volontairement au devoir, quoi qu’il advienne. Ce recours à une hypothèse théologique pour tenter de réunir une éthique du bonheur et une morale du devoir va susciter la critique de Nietzsche, qui se radicalisera en remise en question pure et simple de la morale ainsi comprise.
D’autre part la conception classique d’un sujet pleinement conscient et totalement maître de ses désirs n’est-elle pas une illusion déjà dénoncée par Spinoza, et que Freud s’attachera à déconstruire ? Certes la philosophie de Kant est une philosophie de la liberté entendue comme autonomie. Et elle le conduit à convertir la formule « Tu dois » impliquée dans les dix commandements bibliques pour en faire un « je dois ». Il entend souligner ainsi le fait que l’être humain dispose du pouvoir de se donner à lui-même sa propre loi, souvent à rebours de ses impulsions. Mais qu’advient-il d’un tel présupposé s’il apparaît que l’inconscient existe et que la maîtrise de soi s’en trouve hypothéquée ? Ce deuxième impensé de Kant peut-il survivre à la psychanalyse freudienne, qui justement le met à l’épreuve ? Comment lire Kant pour lui faire intégrer et surmonter une telle objection ?
Dans le sillage de Spinoza et de Diderot, la pensée philosophique va donc se faire déconstruction des illusions théologiques et psychologiques. Elle rejettera une religion de peur et de superstition qui fait de l’abstinence la clef du salut, rompant tout lien entre bonheur et moralité. Dans l’Éthique, Spinoza critique la superstition de l’abstinence et l’irrationalisme des théologiens qui dévoient la spiritualité. Dans son sillage, Diderot articule un hédonisme joyeux et une morale humaniste exempte de toute référence à un dieu. La conciliation de la morale et de l’éthique de l’accomplissement heureux va passer par une critique de la théologie dogmatique de l’Église et par une réhabilitation des désirs humains à rebours de ce que Nietzsche appellera l’idéal ascétique. D’un même mouvement seront dénoncés avec vigueur les dogmes et l’intolérance de l’Église catholique.
L’abstinence comme contre-morale
Est-il moral de prêcher l’abstinence à un être de désir ? La question est d’autant plus vive que pour un croyant c’est Dieu qui a créé cet être et l’a voulu être de désir, mais qui ensuite lui interdirait de jouir pour répondre à ce désir. Paradoxe. La frustration est-elle source de morale ? Ni Épicure, ni Rabelais, ni Spinoza, ni Freud ne le pensent. Pour eux l’hédonisme peut aller de pair avec la morale à condition qu’il s’assortisse du respect d’autrui. La jouissance du violeur est abjecte, car elle est pure violence. Celle de deux êtres qui s’unissent librement ne l’est pas. Diderot est très direct sur ce point. La femme doit toujours être respectée comme sujet libre de disposer de soi, et l’union dans la jouissance de deux personnes qui restent libres de se donner ou non n’a rien de répréhensible. Un extrait remarquable du Supplément au voyage de Bougainville (Chapitre 5) fait dialoguer un aumônier (A) et un Otahitien (B) tenant du naturalisme hédoniste au sujet de l’acte sexuel : « A — Mais comment est-il arrivé qu’un acte dont le but est si solennel et auquel la nature nous invite par l’attrait le plus puissant, que le plus grand, le plus doux, le plus innocent des plaisirs, soit devenu la source la plus féconde de notre dépravation et de nos maux ? B — Orou l’a fait entendre dix fois à l’aumônier. Écoutez-le donc encore et tâchez de le retenir : c’est par la tyrannie de l’homme qui a converti la possession de la femme en une propriété (…) Par les institutions religieuses qui ont attaché les noms de vices et de vertus à des actions qui n’étaient susceptibles d’aucune moralité. »
On voit clairement que ce qui est moralement condamnable ce n’est pas la jouissance libre, mais la domination de l’homme sur la femme, réduite à une chose possédée et à un objet de plaisir. On comprend aussi que la satisfaction des désirs naturels n’a rien de fautif. Une idée se fait jour dans le sillage de Rabelais : la frustration est toujours mauvaise conseillère en matière morale, et elle est bien souvent source de dépravation. La morale n’est pas là pour disqualifier les plaisirs, mais au contraire pour montrer qu’ils sont partie prenante de la vie humaine. Bref, la philosophie des Lumières contemporaine de Kant dessine une perspective originale : celle d’une reconsidération critique du statut de la morale. Avec Nietzsche, celle-ci va prendre la forme d’une véritable déconstruction des illusions classiques, y compris, selon le fondateur de la philosophie du soupçon, celles qui habiteraient l’œuvre de Kant.
La morale en acte de l’humanisme athée
D’Holbach et Diderot, comme plus tard Camus et Sartre sont athées. Donc sans morale ? Voltaire protesterait, en évoquant pour sa part Hobbes et Spinoza. « Hobbes passa pour un athée, il mena une vie tranquille et innocente. Les fanatiques de son temps inondèrent de sang l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande. Spinoza était non seulement athée, mais il enseigna l’athéisme ; ce ne fut pas lui assurément qui eut part à l’assassinat juridique de Barneveldt, ce ne fut pas lui qui déchira les deux frères de Witt en morceaux, et qui les mangea sur le gril. »(1)
Bayle, penseur d’abord protestant, avait rompu le lien exclusif entre morale et religion. Il osait écrire qu’une société d’athées ne serait pas plus immorale qu’une société de païens, voire de chrétiens. Selon lui les lois et l’éducation suffisent pour fournir à l’athée des repères solides. « Il n’est pas plus étrange qu’un athée vive vertueusement, qu’il est étrange qu’un chrétien se porte à toutes sortes de crimes ». D’où une contestation radicale du recours à la violence pour imposer une confession. Bayle faisait de la raison, lumière naturelle de l’homme, l’instance qui peut juger de la légitimité d’une exigence : ainsi, l’autorité des Écritures elle-même ne saurait être opposée à ce que la raison de l’homme lui indique. La liberté de conscience a une telle évidence rationnelle qu’elle ne saurait être contredite par un quelconque principe d’autorité. Dans cet esprit il parlera du « parlement suprême de la raison et de la lumière naturelle ».Voici un extrait des Pensées diverses sur la comète : « On voit à cette heure, combien il est apparent qu’une société d’athées pratiquerait les actions civiles et morales, aussi bien que les pratiquent les autres sociétés, pourvu qu’elle fît sévèrement punir les crimes, et qu’elle attachât de l’honneur et de l’infamie à certaines choses. (…) Avouons donc, qu’il y a des idées d’honneur parmi les hommes, qui sont un pur ouvrage de la Nature, c’est-à-dire de la Providence générale » (2)
La déconstruction de l’évaluation morale religieuse : Nietzsche
Qui dit évaluation se réfère aux valeurs qui inspirent l’action ou la pensée. Qu’est-ce à dire ? Est valeur ce qui vaut. Mais que vaut la disqualification du désir, du plaisir, de la force ? Soupçon. Nietzsche entend déconstruire cette évaluation, c’est-à-dire mettre à nu les ressorts de sa formation. Dans la « Généalogie de la morale », il s’en prend au christianisme en lui reprochant de disqualifier la vie réelle au nom d’un arrière-monde imaginaire. Surtout, il l’accuse de renverser les valeurs de l’accomplissement vital : la force, l’affirmation joyeuse de la vie. Pratiquant le soupçon, il questionne le jugement d’évaluation qui condamne l’usage de la force physique et la satisfaction sans complexe des désirs. Une telle évaluation peut être morale, et concerner strictement le comportement à l’égard d’autrui, ou plus largement existentielle, et s’appliquer à l’art de vivre heureux et accompli. C’est en ce second sens qu’Épicure et Spinoza parlaient d’éthique et disaient que ce qui vaut pour l’homme, par exemple, c’est la maîtrise de soi et la quête des plaisirs. Cultiver cette recherche et la maîtriser par la juste mesure n’a rien de moral ou d’immoral, mais permet l’accomplissement humain, dont peut résulter selon ces deux philosophes une conduite morale au sens premier du terme. À l’inverse, pour la morale chrétienne traditionnelle, qui tend à culpabiliser l’assouvissement des désirs, l’abstinence est valorisée, ce qui pour les hédonistes (en grec hédonè veut dire plaisir) est évidemment paradoxal.
On voit que le sens de l’évaluation met en jeu la conduite de l’existence personnelle et sociale. On évalue davantage la vie d’un être humain que celle d’un animal, ce qui ne veut pas dire que l’on puisse être cruel avec les animaux ni oublier qu’ils souffrent tout comme nous. Est donc valeur ce qui résulte d’une évaluation par un individu ou un groupe. L’acte d’évaluation, conscient ou inconscient, engage des sujets et leurs tendances propres. Qu’est-ce qui le règle ? L’impulsion spontanée, les intérêts particuliers, ou des exigences pratiques universelles, vécues comme indispensables ? Si comme le pense Nietzsche, chacun évalue selon sa situation particulière et ses intérêts propres, il est illusoire de poser l’existence de valeurs universelles. Ce type de relativisme consiste à tirer de la diversité des êtres qui évaluent l’idée que nulle évaluation ne saurait avoir une portée universelle. Au passage, l’idée d’un déterminisme inconscient se fait jour, tandis que toute conduite est considérée comme le produit d’intérêts existentiels plus ou moins explicites, et plutôt moins que plus dès lors qu’ils sont peu avouables. La découverte de l’inconscient n’est pas loin.
Nietzsche radicalise ce constat dans un perspectivisme qui consiste à mettre en perspective toute valeur par rapport aux intérêts et aux contextes particuliers qui ont présidé à sa formation. Tant il semble vrai que ce qui vaut pour moi ici et maintenant peut très bien ne pas valoir pour toi dans d’autres conditions. Ce raisonnement peut paraître un peu court s’il conduit à dénier a priori aux hommes le fait de pouvoir s’élever à des valeurs communes, affranchies des subjectivités particulières, et de portée universelle, ce qui les enferme dans la relativité de leurs conditions d’existence et de leurs désirs ou de leurs rejets. Il vaut du moins comme méthode critique propre à démystifier certaines normes qui se donnent comme universelles alors qu’elles ne font que consacrer une situation existentielle de faiblesse ou au contraire de force, historiquement déterminée. Tel est le sens méthodologique du soupçon nietzschéen.
Ainsi Nietzsche peut-il remarquer que les valeurs d’abstinence et de renoncement mises en avant par le christianisme traduisent souvent un constat implicite d’impuissance. Elles ont alors la propriété de convertir les attitudes de soumission ou de résignation du fait de situations subies en comportements valorisés pour eux-mêmes, pleins de vertu. « Faire de nécessité vertu »… Cette sublimation renverse la perception des réalités au point d’ériger le renoncement en chose louable, et de convertir la soumission en exigence. On calomnie l’affirmation vitale au lieu de changer les rapports de force et la vie par un effort d’accomplissement qui en dépasse les limites présentes. La représentation d’un arrière-monde qui ménage des compensations aux infortunes terrestres parachève le tout. Elle valorise une sorte de désistement qui diffère le bonheur dans l’au-delà, sous le nom de félicité éternelle. Le bonheur c’est toujours pour demain... Même pas, puisque l’au-delà n’est pas un lendemain, mais se situe hors temps et hors monde.
Les analyses de la « Généalogie de la morale » sont sur ce point d’une densité polémique extrême. Elles conduisent à dénoncer la figure d’une humanité disqualifiée par ses désirs supposés indignes, et finalement crucifiée en la personne même du fils d’un dieu étrange, s’incarnant dans un être ensanglanté, torturé par les instruments de la passion entendue comme souffrance subie : fers tranchants, clous, épines, etc. Quelle image des hommes et du dieu incarné qui se fait homme ! La diatribe nietzschéenne prend à rebours deux mille ans de récit chrétien pour y voir l’apologie paradoxale d’une négation de la vie, et la mystification ultime qui « fabrique de l’idéal » en humiliant l’humanité, en lui enjoignant de renoncer à elle-même pour purger une faute imaginaire, si indélébile qu’elle se transmet de génération en génération, comme si l’humanité se trouvait marquée au fer dès l’origine, et ce pour toujours ou presque, du moins dans l’ici-bas.
Mettant en scène la fiction philosophique de la mort de Dieu Nietzsche relate ses conséquences supposées salvatrices. Il s’en réjouit et appelle à s’en réjouir afin de se réapproprier la conduite de l’existence en visant son accomplissement ici-bas. Tel est le sens de son livre intitulé « Le Gai savoir ». Il y affirme que la mort de Dieu ouvre à l’homme un nouveau champ de possibles : « Ces conséquences immédiates, ces conséquences pour nous, ne sont absolument pas, à l’inverse de ce que l’on pourrait peut-être attendre, tristes et assombrissantes, mais bien plutôt pareilles à une nouvelle espèce, difficile à décrire, de bonheur, d’allègement, de réjouissance, d’encouragement, d’aurore… En effet, nous, philosophes et « esprits libres », nous sentons, à la nouvelle que « le vieux dieu » est « mort », comme baignés par les rayons d’une nouvelle aurore. » (3)
Si Dieu n’existe pas, tout est-il permis ?
La définition d’une morale indépendante de la religion choque des croyants qui interprètent la présence du mal sur la terre comme un signe irréfutable de la faiblesse de la nature humaine, de sa « part maudite », voire de son orgueil dans sa volonté d’agir sans tutelle religieuse. Pour Dostoïevsky, seule la religion peut fonder la morale. Dans Les Frères Karamazov Dimitri le dit tout net : « Que faire si Dieu n’existe pas, si Rakitine a raison de prétendre que c’est une idée forgée par l’humanité ? Dans ce cas l’homme serait le roi de la terre, de l’univers. Très bien ! Seulement, comment sera-t-il vertueux sans Dieu ? Je me le demande. [...] En effet, qu’est-ce que la vertu ? Réponds-moi Alexéi. Je ne me représente pas la vertu comme un chinois, c’est donc une chose relative ? L’est-elle, oui ou non ? [...] Alors tout est permis ? » (4)
Jean Paul Sartre proteste. Il reprend à son compte la formule du romancier russe, et l’interprète littéralement comme la mise à nu d’une liberté fondamentale. L’expression « tout est permis » signifie alors que l’existence humaine n’est pas soumise a priori à des normes prédéfinies, et qu’elle est libre de toute attache. Mais cela n’implique nullement qu’elle soit vouée au crime et à l’absence de tenue. Sous un ciel vide, c’est à l’être humain de s’inventer des repères. Sa liberté fondamentale est de se faire, de se choisir tel ou tel. Une liberté ontologique, donc, puisque c’est de son être même que l’homme décide en choisissant d’agir comme il le fait. Nous sommes ce que nous nous faisons. Mais toujours nous pouvons transcender ce que nous avons fait et agir autrement, donc nous faire autres. D’où le vertige d’une liberté qui peut se faire angoisse. Une morale existentielle, et existentialiste, s’esquisse ici. Elle articule une éthique de la liberté déployée dans l’action et une responsabilité radicale à la fois pour soi-même et pour les autres.
Relisons Sartre : « Dostoïevski avait écrit : « Si Dieu n’existait pas, tout serait permis. » C’est là le point de départ de l’existentialisme (…) Si, en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit, pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté. Si, d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n’avons ni dernière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. ». (L’existentialisme est un humanisme)
La découverte de l’inconscient, blessure narcissique
Un autre éclairage critique de la morale kantienne peut être maintenant envisagé. La découverte de l’inconscient psychique et de son emprise multiforme sur la subjectivité humaine ne conduit-elle pas à une remise en question de la vision classique d’un sujet humain transparent à lui-même ? N’ébranle-t-elle pas l’idéal de maîtrise intérieure qui des stoïciens à Descartes et de Descartes à Kant constitue une orientation essentielle de la réflexion éthique ? La psychanalyse freudienne souligne l’importance des illusions de la conscience, et le caractère lacunaire de toute approche qui ne les prendrait pas en compte, ne serait-ce que pour interpréter des phénomènes courants. Le rêve, les lapsus, les actes manqués, les symptômes pathologiques, entre autres, incitent à une analyse en profondeur de l’existence de déterminations psychiques qui échappent tout d’abord à la conscience et en signalent les limites.
Dans un texte portant sur ce qu’il appelle les humiliations (ou les blessures) du narcissisme humain, Sigmund Freud n’hésite pas à inscrire la révolution psychanalytique dans le sillage de deux grandes révolutions scientifiques. En premier lieu celle que provoque Copernic en expliquant que la terre n’est pas le centre du monde, et que le géocentrisme n’est qu’une illusion de perspective. En second lieu celle que conçoit Darwin en insérant l’être humain dans la série animale dont la religion l’avait séparé. Bref, dans les deux cas, c’est l’illusion d’occuper une place singulière et privilégiée dans l’Univers qui s’effondre. Mais avec la psychanalyse c’est l’idée que l’être humain se fait de lui-même et de son libre arbitre qui est touchée. Lisons Freud : « Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours, qui se propose de montrer au moi qu’il n’est seulement pas maître dans sa propre maison, qu’il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique (…)D’où la levée générale de boucliers contre notre science, l’oubli de toutes les règles de politesse académique, le déchaînement d’une opposition qui secoue toutes les entraves d’une logique impartiale » (5)
Pour la morale classique, si l’on en croit Freud, le coup est dur, dès lors que la conscience n’est plus maîtresse de l’intériorité psychique, et que des motivations inconscientes, souvent incontrôlées, agissent à son insu. Le sujet humain exprimé par le pronom personnel « je » n’existe pas d’emblée tout constitué. Freud imagine une sorte de tripartition du psychisme pour rendre compte du dynamisme de la vie affective. La première instance est celle du « cà », ensemble des pulsions c’est-à-dire des désirs inconscients qui tendent à leur assouvissement et pour cela cherchent à devenir conscients. La seconde instance est le « surmoi », sorte de vigile qui incarne les exigences de la vie sociale et du contrôle qu’elle requiert, capable de refouler les désirs inconscients par une censure qui les empêche de devenir conscients lorsqu’ils contreviennent aux convenances sociales et morales. Ne pouvant être assumés en vue de leur satisfaction par la volonté consciente, ils sont donc « refoulés » comme le seraient des personnes qui tentent de franchir la frontière sans papiers en règle. Un texte de Freud précise un tel rôle : « Le surmoi est une instance inférée par nous, la conscience morale une fonction que nous lui attribuons à côté d’autres, ayant à surveiller et juger les actions et les visées du moi, exerçant une activité de censure. Le sentiment de culpabilité, la dureté du surmoi, est la même chose que la sévérité de la conscience morale il est la perception, impartie au moi, de la surveillance à laquelle celui-ci est ainsi soumis » (6). En fin de compte, le moi proprement dit, exprimé par le je a pour fonction d’assurer le compromis entre des exigences également légitimes. Il se doit de concilier la satisfaction des désirs et celle des convenances morales et sociales fondées. Une telle conciliation, qui exclut aussi bien la jouissance échevelée et sans mesure que la disqualification de tout plaisir, fonde l’équilibre et partant le bonheur. Le « surmoi » fait valoir inconsciemment, mais aussi consciemment des exigences de nature morale, si l’on entend par là des exigences destinées au respect d’autrui. Freud résume le travail sur soi qui se joue alors : « Là où était le çà, je dois advenir ».
D’un point de vue éthique, Freud a été tourmenté durablement par la question du statut de l’agressivité humaine, si manifeste dans les guerres, le terrorisme, et les affrontements en tous genres. Cela invite à s’interroger sur ce qu’il appelle la pulsion de mort, « Thanatos » (en grec, mort) au regard de la pulsion d’amour et de vie, qu’il appelle « Éros » (en latin Cupidon). Éros et Thanatos : amour et mort violente. D’où nous vient ce tragique dualisme ? Inné ou acquis ? L’optimisme premier de Freud renoue avec l’idée que seule la frustration indue des désirs est pathogène et source de violence compensatoire, donc de fautes morales. Par conséquent la satisfaction équilibrée des désirs, dans le respect d’autrui et de sa liberté, conditionne la paix entre les hommes, et elle est bien meilleure conseillère, sur le plan moral, que l’abstinence cultivée par les chrétiens au nom de la spiritualité. Mais ce schéma optimiste est ébranlé par la Première Guerre mondiale, et Freud en vient à penser alors que l’agressivité est naturelle, au point de constituer une « pulsion » inscrite en chaque homme au même titre que la pulsion d’amour et de vie, la pulsion de mort. Éros et Thanatos se mêlent inexorablement, affectant l’existence d’expériences contradictoires.
Aux processus primaires d’une satisfaction réflexe des impulsions éprouvées se substituent des processus secondaires qui résultent d’une composition de forces entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Selon Freud la morale religieuse hypertrophie le contrôle exercé par le surmoi au point de la rendre pathogène. Avec l’inconvénient d’assujettir la régulation morale à la croyance, et de lui donner ainsi le caractère apparent d’une contrainte extérieure, aussi incertaine qu’une croyance sujette à s’effondrer. L’homme devrait plutôt comprendre que c’est lui qui a créé les lois morales, et ce dans son propre intérêt, afin de les affranchir de la religion.
Conclusion : la morale réaffirmée
Dès lors que la morale se laïcise et s’émancipe dans ses énoncés de toute norme illégitime, elle peut survivre aux critiques de Nietzsche et de Freud. Elle peut même les intégrer pour se définir de façon plus solide. Trois points forts sont alors en jeu. D’une part la morale du devoir n’a pas ou plus à se construire contre une éthique du bonheur. L’acquis des philosophies antiques et celui de la morale kantienne peuvent converger dans une synthèse originale pressentie par Spinoza puis les philosophes des Lumières. La théologie de la part maudite de l’homme liée au péché originel reste alors une conviction particulière des seuls croyants et elle n’est plus opposée à une morale universelle que Kant a voulu définir indépendamment de toute religion. D’autre part une morale commune à tous les êtres humains n’a pas à se plier à des culpabilisations indues ni à se vivre à la façon d’un commandement extérieur, étranger aux exigences de l’accomplissement de soi. Une telle hétéronomie, souvent liée à une religion de peur qui guette toute conduite et fait peser sur elle la menace d’un châtiment divin, semble contraire à la liberté. De fait la violente critique du christianisme à laquelle se livre Nietzsche n’atteint qu’une morale de l’abstinence qui disqualifie la vie et le désir d’accomplissement terrestre. Elle devient sans objet en cas de refondation de la morale par une éthique du bonheur. Il ne s’agit plus alors de se résigner à une situation de faiblesse existentielle en faisant de nécessité vertu, mais d’user de courage pour dépasser cette situation concrète et en faire advenir une autre.
Par ailleurs la critique freudienne des illusions de la conscience et des culpabilisations religieuses indues ne met pas en cause toute exigence morale. Le rôle du surmoi comme instance de régulation des conduites atteste que Freud admet l’exigence morale dès lors qu’elle prend le relais d’une nécessité sociale authentique. Qu’elle soit assumée d’abord de façon inconsciente par le biais de refoulements ne l’empêche pas de l’être ensuite de façon consciente, par des renoncements volontaires. La cure psychanalytique permet au patient de se révéler à lui-même qu’il peut très bien assumer un désir désormais identifié comme légitime et non coupable. C’est alors que le fameux « je » d’une personne délivrée de ses blocages intérieurs peut advenir en lieu et place d’un magma de pulsions non maîtrisées et non intégrables comme telles à l’ordre public. Cet avènement est un processus souvent difficile de libération, et non la manifestation spontanée d’un sujet d’emblée maître de soi. Entre le « deviens ce que tu es » de Nietzsche et le « tu dois donc tu peux » de Kant un travail sur soi rend digne du bonheur en cultivant le respect de l’humanité d’autrui comme fin et pas seulement comme moyen (Kant). Une parenté des formules peut s’affirmer. « Là où est le « çà » je dois advenir », disait Freud dans le même esprit. Ainsi la refondation de la théorie classique du sujet agissant par une mise en évidence du rôle majeur de l’inconscient psychique n’annule pas la conception kantienne. Celle-ci insiste sur la plasticité et l’éducabilité de l’être humain, et sur le rôle des exercices chers aux stoïciens dans la construction de la maîtrise de soi. Le devenir conscient peut être alimenté par la réflexion. Il me fait comprendre et priser ce qui permet mon accomplissement propre dans le cadre de l’accomplissement collectif. Bref, si Freud a dit les choses en des termes nouveaux, il n’a peut-être fait que redécouvrir un impératif moral désormais délivré de toute culpabilisation religieuse. Il l’a intégré à une éthique du bonheur comme équilibre entre l’assouvissement des désirs et la concorde sociale.
La morale sort donc réaffirmée de sa mise à l’épreuve par les philosophies du soupçon. Mais elle ne peut être pleinement crédible que si elle se distingue nettement du moralisme et de l’hypocrisie qui trop souvent accompagnent des pratiques sordides d’exploitation de l’homme par l’homme.
Notes :
1 : Dictionnaire Philosophique, article athéisme
2 : Bayle, Pensées diverses sur la comète, t. II, Nizet, 1984, p. 102 sq.
3 : Le Gai Savoir, §343
4 : Dostoïevski Les frères Karamazov, 4e partie, Livre XI, chapitre 4
5 : Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse (1916), Ile partie, chap. 18, trad. S. Jankélévitch, Éditions Payot, « Petite Bibliothèque », 1975, p. 266-267
6 : Malaise dans la civilisation, VIII, p. 79, P.U.F., collection Quadrige